En 2006, on a la surprise de découvrir le nom de Jean Rouaud sur un album de bandes dessinées. Comment un romancier récompensé par un Prix Goncourt se retrouve-t-il dans le monde des "petits miquets" ?
Jean Rouaud:Au départ il ne s’agit pas de mon idée mais bien d’une envie de Denis Deprez qui m’avait contacté pour me proposer d’adapter mon roman, Les champs d’honneur. Ceci s’est fait d’ailleurs sous l’impulsion de Benoît Peeters, le célèbre scénariste-éditeur-critique de bande dessinée à qui j’avais fait part de mon intention d’œuvrer pour ce média. Auparavant j’avais déjà rencontré quelques dessinateurs et plus particulièrement Frédéric Boilet avec qui nous avions entamé une collaboration. Celle-ci n’a pu aboutir car il a rapidement déménagé pour le Japon où il a été surchargé de travail. Peeters a alors cherché un autre auteur et a contacté Denis Deprez qui m’a envoyé une belle lettre accompagnée de son adaptation du Frankenstein de Mary Shelley. J’ai été ravi de découvrir son travail. Avec cet album il me montrait sa palette et aussi son désir de se remettre en question pour aborder Les champs d’honneur. Il souhaitait raconter une histoire plus contemporaine.

Qui s’est chargé de l’adaptation de son adaptation ?
JR : Ce fut en fait assez simple car, dès le départ, j’ai laissé carte blanche à Denis, j’avais vraiment l’intention de le laisser complètement libre. Il a quasiment un travail de recréation en changeant les points de vue. Ce fut pour moi une incroyable surprise car je pensais que ce livre ne tenait que par l’écriture, je doutais de la solidité de l’histoire. Débarrassés de l’écriture, il ne restait que des êtres qui se débattaient dans leur chagrin, ce qu’a mis en avant la bande dessinée. Il y a là une intensité dramatique sans contrepoids humoristique qui a été mise en avant sans les digressions romanesques.
Pourquoi vous être tourné ensuite vers une adaptation de roman de Melville ?
Denis Deprez : Je crois que nous aimons nous lancer des défis, varier les plaisirs ! C’était vraiment interessant de sortir de l’univers de Jean, d’aller voir ailleurs. Pourquoi Moby Dick ? Il y a sans doute notre volonté commune d’adapter des récits qui sont devenus des grands mythes en littérature et qui me permettent de pouvoir mettre en place certaines formes picturales différentes de ce qui peut se trouver dans la bande dessinée dite traditionnelle, plus convenue. Il y a cette ossature solide du récit qui m’offre la possibilité de mettre en branle tout un travail sur la couleur, sur la composition, sur l’atmosphère... J’avais aussi le désir d’un livre qui parlerait de marine, La ballade de la mer salée de Hugo Pratt est un de mes livres de chevet et j’avais envie de me faire plaisir tout simplement en proposant une aventure humaine sur la mer.
L’influence de Pratt se fait d’ailleurs sentir dans certaines scènes...
DD : Oui, c’est évident, il fait partie de mon panthéon au côté de Breccia, Munoz et Sampayo, la divine école argentine de Buenos Aires ! J’apprécie tout particulièrement la façon dont ces auteurs représentent l’âme humaine dans leurs histoires. Avant de m’atteler à Moby Dick, j’ai tout relu Pratt pour comprendre comment il faisait vibrer ses personnages, comment il faisait pour émouvoir le lecteur.
JR : C’est vrai que la première image de notre livre peut évoquer Corto Maltese, arrivant avec son sac sur l’épaule dans un port ; il s’agit presque d’une citation. Il ne sert à rien de se débarrasser de ses influences, il faut seulement les digérer et, l’inconscient travaillant , vous fera proposer une œuvre nouvelle. On peut d’ailleurs être dans la citation ou l’hommage et non dans le pastiche. C’est aussi une manière de dialoguer entre pairs ou pères (!), un signe de bonne santé artistique. Une façon aussi de faire remarquer que la bande dessinée a un passé riche, une histoire ; qu’on peut y trouver ses influences et choisir sa famille, s’y trouver en bonne compagnie.
DD : Je suis d’ailleurs heureux que vous souleviez ce point car on a souvent tendance à définir mon travail comme celui d’un peintre et non d’un auteur de bandes dessinées. Or, moi, je revendique justement cet aspect de bande dessinée. Je suis heureux que l’on puisse déceler une filiation avec quelqu’un comme Pratt car il est un des plus grands auteurs de BD !
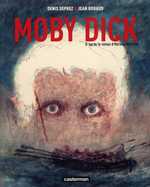
Pourtant, vos approches graphiques divergent, Pratt est un esthète de la ligne alors que vous, vous semblez plutôt travailler sur la matière et la force des couleurs
DD : C’est tout simplement parce que je vais chercher des éléments de représentation qui sont extérieurs à la bande dessinée, que je les y intègre. Mais tous les codes mis en place sont proppres à ce média. Je ne fais pas de crayonnés, je pose directement l’aquarelle sur le papier ; il s’agit de lignes et de masses qui vont petit à petit constituer l’ossature du récit. Mais parallèlement je vais utiliser l’architecture du bateau, les haubans, les drisses pour appuyer la composition de la planche.
Vous sollicitez beaucoup l’intelligence du lecteur tant votre dessin fait appel à l’émotion, au ressenti, comme pouvait le faire le peintre Turner. On est loin de l’approche documentaire d’un Bourgeon ou d’un Vance.
DD : Il suffit de quelques lignes esquissées pour représenter un navire. Comme me l’expliquait récemment Benoît Peeters, le cèlèbre dessinateur Töpffer qui fut le premier « auteur » de bande dessinée, démontrait que si l’on représentait un âne derrière un arbre en quelques traits simples, un enfant serait capable de l’identifier ; tandis que si l’on proposait un dessin plus sophistiqué, il peinerait à le comprendre. En quelques traits, l’imaginaire travaille mieux et n’est pas encombré d’informations inutiles au récit.
De là, l’importance que vous accordez aux couleurs
DD : Tout à fait, la couleur guide aussi l’histoire, avec des gris, des bleus, des rouges pour les scènes d’équarissage. Tous ces procédés servent à donner des moments de tension, à établir une certaine dramaturgie.
Pour en revenir à l’adaptation du roman, comment fait-on pour passer d’un texte de plus de 800 pages à une bande dessinée de 120 ?
JR : En fait, le texte initial est composé de beaucoup de chapitres exogènes, qui ne servent pas directement l’histoire. Il y a notamment de longues scènes sur Jonas et la baleine, sur les cétacés, sur la vie à bord du bateau, des passages presques documentaires. Si l’on devait définir le squelette de l’histoire on pourrait parler d’un jeune marin qui embarque sur un bateau chasseur de baleines, dirigé par un capitaine ivre de vengeance. Le problème était de ne pas réduire l’adaptation à cette seule trame mais aussi d’y introduire des éléments qui peuvent sembler inutiles mais qui installent un certain climat, une vérité historique. L’importance de la blancheur comme symbôle du mal, thèse développée par Melville, a été je pense génialement rendue par Denis quand il représente le capitaine Achab avec des cheveux et une barbe blanche ! Denis a aussi bien intégré cette notion du mal incarnée par le blanc dans ces scènes de vagues déferlantes, aux planches laiteuses ou le blanc agresse presque l’œil.
DD : Je pense qu’on n’a pas trahi Melville dans notre traitement, on a réussi à ne pas négliger le côté dramatique tout en n’occultant pas certains aspects documentaires comme lors du passage racontant la première chasse.
Votre adaptation est peu dialoguée, laissant le soin au lecteur de composer sa propre bande son
JR : Le parti pris a été de ne pas utiliser un langage réel afin de renforcer la dramaturgie. De plus, les personnages sont dans une espèce de mystique qui permet cela. Le dessin est assez fort pour éviter tout texte inutile qui pourrait être redondant.
Pour aborder un aspect plus technique, comment travaillez-vous ensemble ?
DD : En fait, Jean et moi faisons chacun de notre côté un résumé de l’histoire. Puis on se réunit quelques jours pendant lesquels on remet le roman à plat. On choisit les événements que l’on veut reprendre. Dans un carnet, on va établir le plan de notre adaptation, une page du carnet correspondant à une page de la bande dessinée. Chaque planche devra correspondre à un ou deux événements décrits dans le roman. On construit ainsi la trame narrative qui constituera la base solide de mon travail. C’est aussi le moment où l’on définit les personnages, où on les caractérise. Ensuite, je commence à construire le récit, je storyboarde chaque planche. Je travaille au jour le jour, page après page et non par séquences comme certains de mes confrères ; je ne peux travailler que dans la continuité. L’étape suivante est la mise au net. Dès que j’ai dessiné une série de pages, je les envoie à Jean qui découvre alors mon travail. C’est là une approche interessante, car il va devoir réagir aux dessins proposés et y intégrer les éléments narratifs définis au départ. On se laisse à chacun un grand espace de liberté dans le cadre d’une dramaturgie bien cadrée.
Vous utilisez peu les artifices propres à une certaine bande dessinée historique abondant en dates et en récitatifs temporels...
DD : C’est la force du travail de Jean d’apporter cette temporalité par ses dialogues. Dans ce travail réalisé à deux, il y a le temps du récit que je développe, puis il y a le temps de Jean ; et ces deux temps qui se chevauchent doivent former un récit de bande dessinée.

De même vous ne semblez pas apprécier les phylactères classiques, à savoir une belle bulle sur fond blanc. Vous proposez une approche plus discrète, plus transparente. Pourquoi ?
DD : J’ai effectivement utilisé cette transparence car je voulais pas que le blanc des bulles troue les pages. Je voulais que les textes s’intègrent réellement et ne soient pas comme une pièce rattachée. De plus, dans ce récit, le blanc a une telle importance symbolique qu’il me fallait trouver une solution différente.
JR : Il s’agit probablement de l’aspect du livre sur lequel on a le plus réfléchi quant à la forme à adopter. On voulait un aspect un peu vieilli pour faire "d’époque" et renforcer ainsi la force des dialogues.
DD : Le fait d’avoir tracé les phylactères au pinceau faisait en fait écho au trait de pinceau de la planche et créait ainsi une bonne vibration.
De quoi sera fait votre avenir ?
JR : Nous allons nous retrouver pour une nouvelle adaptation. Nous allons partir d’un texte peu connu qui raconte les mémoires d’une jeune anglaise, âgée de quarante ans et prétendument malade qui va se retrouver dans les Rocheuses à l’époque de la conquête de l’Ouest. Une sorte de western victorien.

Merci à José Roland et à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles pour avoir permis cette rencontre.
(par Erik Kempinaire)
Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.
Le Site de Deprez
les illustrations sont (c) Rouaud, Deprez et Casterman
la photo est (c) C. Verheylewegen
Participez à la discussion